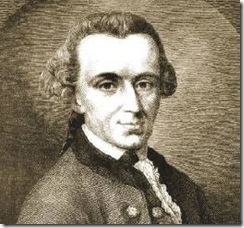 Si la critique ne s'est pas trompée en enseignant à prendre l'objet en une double signification, savoir comme phénomène ou comme chose en soi; si la déduction de ses concepts de l'entendement est juste, si donc le principe de causalité ne se rapporte qu'aux choses dans le premier sens, en tant qu'elles sont objets de l'expérience, tandis que ces mêmes choses selon la seconde signification ne lui sont pas soumises, alors la même volonté sera pensée dans le phénomène (les actions visibles) comme nécessairement conforme à la loi de la nature, et dans cette mesure comme non libre, et cependant, d'un autre côté, comme appatrenant à une chose en soi, comme non soumise à cette loi, par suite comme libre, sans qu'il se produise là une contradiction. Quoique je ne puisse connaître mon âme, considérée du second point de vue, au moyen d'une raison spéculative (moins encore par l'observation empirique), et que je ne puisse non plus par suite connaître la liberté comme propriété d'un être auquel j'attribue des effets dans le monde sensible (...), je puis cependant penser la liberté, c'est-à-dire que sa représentation ne contient du moins en elle aucune contradiction (...). Or, une fois admis que la morale suppose nécessairement la liberté (au sens strict) comme propriété de notre volonté, en apportant a priori comme données de notre raison les principes pratiques originels qui se trouvent en elle, et qui sans la supposition de la liberté, seraient absolument impossibles: si la raison spéculative avait démontré que la liberté ne peut pas du tout être pensée, il faudrait alors nécessairement que la première supposition, la supposition totale cède devant celle dont le contraire contient une contradiction flagrante, par suite, la liberté et avec elle la moralité - dont le contraire ne contient aucune contradiction, si la liberté n'est pas déjà présupposée) laissent la place au mécanisme de la nature. Mais comme j'ai seulement besoin pour la morale que la liberté ne se contredise pas elle-même, et puisse donc du moins être pensée, sans qu'il soit nécessaire encore d'en avoir une intuition, comme donc la liberté ne fait aucun obstacle au mécanisme de la nature pour la même action (prise sous un autre rapport), la doctrine de la moralité peut garder sa place et la physique la sienne, ce qui n'aurait pas eu lieu, si la critique ne nous avait d'abord appris notre ignorance inévitable à l'égard des choses en soi et n'avait restreint tout ce que nous pouvons connaître théoriquement à de simples phénomènes(...). Je ne puis donc même pas admettre Dieu, la liberté et l'immortalité au service de l'uasge pratique nécessaire de ma raison, si je ne démets en même temps que la raison spéculative de sa prétention à des intuitions transcendantes, parce que pour y parvenir elle doit se servir de principes qui, du moment qu'ils ne s'étendent en fait qu'aux objets de l'expérience possible, et s'ils sont cependant appliqués à ce qui ne peut être un objet de l'expérience possible, et s'ils sont cependant appliqués à ce qui ne peut être un objet de l'exprience possible, et s'ils sont cependant appliqués à ce qui ne peut être un objet de l'expérience, le transforment réellement en phénomène, et déclarent ainsi impossible toute extension pratique de la raison pure. Je devais donc supprimer le savoir, pour trouver une place pour la foi (...) KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure, Préface de la 2è édition, trad. Barni, Delamarre, Marty, Gallimard, "Folio", p. 52-45
Si la critique ne s'est pas trompée en enseignant à prendre l'objet en une double signification, savoir comme phénomène ou comme chose en soi; si la déduction de ses concepts de l'entendement est juste, si donc le principe de causalité ne se rapporte qu'aux choses dans le premier sens, en tant qu'elles sont objets de l'expérience, tandis que ces mêmes choses selon la seconde signification ne lui sont pas soumises, alors la même volonté sera pensée dans le phénomène (les actions visibles) comme nécessairement conforme à la loi de la nature, et dans cette mesure comme non libre, et cependant, d'un autre côté, comme appatrenant à une chose en soi, comme non soumise à cette loi, par suite comme libre, sans qu'il se produise là une contradiction. Quoique je ne puisse connaître mon âme, considérée du second point de vue, au moyen d'une raison spéculative (moins encore par l'observation empirique), et que je ne puisse non plus par suite connaître la liberté comme propriété d'un être auquel j'attribue des effets dans le monde sensible (...), je puis cependant penser la liberté, c'est-à-dire que sa représentation ne contient du moins en elle aucune contradiction (...). Or, une fois admis que la morale suppose nécessairement la liberté (au sens strict) comme propriété de notre volonté, en apportant a priori comme données de notre raison les principes pratiques originels qui se trouvent en elle, et qui sans la supposition de la liberté, seraient absolument impossibles: si la raison spéculative avait démontré que la liberté ne peut pas du tout être pensée, il faudrait alors nécessairement que la première supposition, la supposition totale cède devant celle dont le contraire contient une contradiction flagrante, par suite, la liberté et avec elle la moralité - dont le contraire ne contient aucune contradiction, si la liberté n'est pas déjà présupposée) laissent la place au mécanisme de la nature. Mais comme j'ai seulement besoin pour la morale que la liberté ne se contredise pas elle-même, et puisse donc du moins être pensée, sans qu'il soit nécessaire encore d'en avoir une intuition, comme donc la liberté ne fait aucun obstacle au mécanisme de la nature pour la même action (prise sous un autre rapport), la doctrine de la moralité peut garder sa place et la physique la sienne, ce qui n'aurait pas eu lieu, si la critique ne nous avait d'abord appris notre ignorance inévitable à l'égard des choses en soi et n'avait restreint tout ce que nous pouvons connaître théoriquement à de simples phénomènes(...). Je ne puis donc même pas admettre Dieu, la liberté et l'immortalité au service de l'uasge pratique nécessaire de ma raison, si je ne démets en même temps que la raison spéculative de sa prétention à des intuitions transcendantes, parce que pour y parvenir elle doit se servir de principes qui, du moment qu'ils ne s'étendent en fait qu'aux objets de l'expérience possible, et s'ils sont cependant appliqués à ce qui ne peut être un objet de l'expérience possible, et s'ils sont cependant appliqués à ce qui ne peut être un objet de l'exprience possible, et s'ils sont cependant appliqués à ce qui ne peut être un objet de l'expérience, le transforment réellement en phénomène, et déclarent ainsi impossible toute extension pratique de la raison pure. Je devais donc supprimer le savoir, pour trouver une place pour la foi (...) KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure, Préface de la 2è édition, trad. Barni, Delamarre, Marty, Gallimard, "Folio", p. 52-45
COMMENTAIRE DE TEXTE
Mots clés Technorati : KANT , Critique , Raison , Métaphysique , Dogmatisme , Morale , Scepticisme , Foi , Liberté , Phénomène , Chose en soi
Dans la préface à la seconde édition de la Critique de la Raison Pure, Kant se plaint d'avoir été mal compris, et mal compris par des "hommes perspicaces", des lecteurs impartiaux, lumineux et amis de la vraie popularité, des hommes distingués qui, à la sûreté de vue, allient si heureusement encore le talent d'une claire exposition, et qui se distinguent de ces juges, qui, à la manière de celui auquel Kant règle son compte à la fin des Prolégomènes, condamnent sans s'être donné la peine de livre qu'ils rejettent. Mal, compris, et Kant l'ajoute, peut-être par sa faute. La nouvelle édition remédierait à cela.
Le même désir de rendre plus accessible sa pensée s'exprime dans plusieurs lettres écrites pendant qu'il travaillait à cette nouvelle édition: "Je tiendrai compte (pour la seconde impression, qui rendra moins urgente la rédaction d'une métaphysique) de toutes les interprétations erronées ou bien aussi des passages incompréhensibles dont j'ai eu connaissance depuis que cet ouvrage est mis en circulation"; "je suis à présent occupé...à une seconde édition de la Critique et je m'efforce d'élucider différentes sections de celles-ci, dont la mauvaise compréhension a produit toutes les objections faites jusqu'ici."
Les formules de la préface à la seconde édition doivent donc être prises au sérieux, et il y a lieu de se demander en quoi consistaient aux yeux de Kant ces malentendus qu'il croyait devoir éliminer au prix d'un effort qu'il n'a pas fourni qu'à cette occasion, car, en ce qui concerne presque toutes ses autres publications, il ne s'intersse guère aux rééditions.
Il n'est pas difficile de désigner les auteurs et l'occasion qui onté déterminé Kant. L'article de 1786, Que signifie: s'orienter dans la pensée?, et la note consacrée aux Morgenstuden de Mendelssohn l'indiquent clairement: entre le wolffianisme mendelsshnien et la philosophie de la foi de Jacobi, Kant semble obligé de prendre position - et ne peut le faire, étant donné qu'il est également opposé au dogmatisme de l'un et au fidéisme de l'autre. Pour lui, les deux ne peuvent conduire qu'au scepticisme, et puisque sa propre position se situe à un autre niveau, il est incapable de choisir entre des adversaires qui, l'un comme l'autre, lui paraissent avoir tort, quoi que pour des raisons inverses et de manière différente. Il ne veut être ni sceptique ni dogmatique, toue sa philosophie tend à dépasser la nécessité d'une telle position; mais il n'a pas été compris.
L'interprétation la plus superficielle de la pensée kantienne tiendra compte de cette intention de dépassement. Cela dit, ce que Kant appelle un malentendu subsiste et l'on affirme souvent, bien que de points de vue opposés que Kant n'aurait pas réussi dans son entreprise: selon les uns, parmi lesquels bon nombre de néo-kantiens, il n'aurait pas évité la métaphysique, terme en ce contexte et sous ces plumes nettement péjoratif; pour les autres, dont le chef de fil fut Hegel, il aurait penché, coupablement, du côté d scepticisme ou, à tout le moins, du subjectivisme. Sous ces conditions, il pourrait être utile de réexaminer l'enseignement de Kant lui-même, afin de découvrir si l'une des partis a raison et laquelle; ou, au cas où les deux se seraient trompés, pour élucider ce qui a induit en erreur les deux écoles, puisque leurs erreurs, si erreur il y a, ne sont pas, du propre aveu de Kant, entièrement de ler faute. Il faudra donc exposer ce qui est la pensée de Kant; ou plutôt, puisqu'il est impossible d'exprimer plus brièvement que l'auteur la pensée d'un vrai philosophe (sans quoi il ne serait pas un vrai philosophe), il faudrait enlever les sédimentations qui obstruent l'accès à cette oeuvre difficile.
Une comparaison, même rapide, des deux éditions de la Critique de la Raison Pure montre où Kant situe les malentends dont il se plaint. A vrai dire, la seule comparaison des deux Préfaces permet déjà de constater qu'un seul point importe à Kant. En effet, la première Préface a affaire au dogmatisme, la seconde se tourne contre le scepticisme.Si en 1781, Kant insiste sur l'absence de tout progrès et donc sur la valeur douteuse de la métaphysique, en 1787, il affirme, au contraire, la nécessité d'une telle science et parle d'objets " (du moins tels que la raison les conçoit) être donnés dans l'expérience", mais "il faut pourtant qu'on puisse les penser)"; et il parle de la possibilité de trouver dans la connaissance pratqiue "des donnés qui lui permettent de détermner ce concept rationnel transcendant de l'Inconditionné". Surtout, il proteste contre une façon de voir qui retiendrait de la Critique seulement son aspect négatif et ignorerait la fonction positive d'une limitation de la raison spéculative (on dirait mieux: constructiviste), limitation à laquelle la raison pratique doit de pouvoir dorénavant procéder à la découverte du supra-sensible sans avoir à craindre les objections d'une raison théorique, auparavant présompteuse, à présent consciente de ses limites; la chose-en-soi, la foi de la raison, la pensée de l'absolu sont présentées au lecteur avant même qu'il n'ait accédé à l'ouvrage même. Ce passage que nous avons à commenter nous fait comprendre le rapport établi par Kant entre sa philosophie de la connaissance Critique de la raison pure et sa morale Critique de la raison pratique. Il est plus parlant qu'il n'y paraît, si l'on prend soin de l'étudier avec minutie, si l'on a quelques notions sur Kant, et si l'on médite la fin du morceau, qui dévoile tout l'ensemble. Moment philosophique capital, parce qu'il fournit les clefs de lecture de l'oeuvre kantienne, ce texte remplit du point de vue méthodologique, pour la même raison, la triple fonction d'initiation, de test et de banc d'essai.
Le texte commence par affirmer que la Critique ne se trompe pas quand elle affirme que l'objet a une double signification: le phénomène et la chose en soi. Le phénomène est ce qui apparaît à la conscience ou bien ce qui est perçu, tant dans l'ordre physique que psychique. Au sens le plus large, le phénomène est un fait constaté qui constitue la matière des sciences. Pour Kant, est phénomène tout ce qui est "objet d'expérience possible" c'est-à-dire tout ce qui apparaît dans le temps ou dans l'espace, et qui manifeste les rapports déterminés par les catégories. Il l'oppose, d'une part, à la pure matière de la connaissance; de l'autre, et surtout au noumène ou à la chose en soi. Le noumène est quant à lui, la réalité intelligible, l'objet de la raison, opposée à la réalité sensible; et par suite il est la réalité absolue, la chose en soi. La tradition platonicienne, renforcée par l'opposition chrétienne du monde sensible et du monde spirituel, identifie la connaissance vulgaire à l'apparence et à l'illusion et la connaissance rationnelle à la pensée des choses telles qu'elles sont. De là vient que le mot noumène a passé graduellement, dès l'époque de Kant, et dans la Critique de la Raison pure, d'un sens purement critique à un sens purement ontologique: "Si j'admets des choses, qui soient de purs objets de l'entendement, et qui pourtant, en tant que tels, puissent être données à une intuition, quoique ce ne soit pas à l'intuition sensible...des choses de ce genre seraent appelées noumènes." En ce sens, la notion de noumène est purement négative: "Le concept d'un noumène n'est donc pas le concept d'un objet, mais seulement ce problème, inévitablement lié à ce fait que notre faculté de connaître par les sens est limitée: ne pourrait-il pas y avoir des objets tout à fait indépendants de cette intuition sensible?" Elle supposerait"...Une tout autre intuition et un tout autre entendement". Mais on peut aussi entendre noumène en un sens positif: "Mais si nous entendons par là l'objet d'une intuition non sensible, nous admettons alors une sorte particulière d'intuition, l'intuition intellectuelle qui, à la vérité, n'est pas la nôtre, et dont nous ne pouvons même pas comprendre la possibilité: et ce serait le noumène au sens positif." Ainsi entendue, la Raison pratique nous garantit la réalité du noumène, bien qu'elle ne nous en donne pas l'intuition; car, pour pouvoir attribuer un sens à l'idée de liberté, condition nécessaire de la loi morale, "Il ne reste pas d'autre voie possible que d'attribuer au phénomène seul l'existence d'une chose, en tant qu'elle est déterminée dans le temps (et par conséquent aussi la causalité suivant les lois de la nécessité naturelle); et d'attribuer la liberté à ce même être en tant que chose en soi." En effet, dit Kant, ce même sujet, qui se connaît lui-même en tant que succession de phénomènes "Il a aussi conscience de lui-même de lui-même, en tant que chose en soi."; et à cet égard, "pour la conscience de son existence intelligible, toute la série successive de son existence, en tant qu'être sensible, ne doit être considérée que comme la conséquence et jamais comme le principe déterminant de sa causalité, en tant que noumène." Dans la Métaphysique des moeurs , il désigne le sujet de la moralité par l'expression homo noumenon. A suivre..... Dr AKE PATRICE JEAN, Maître-Assistant en Philosophie à l'UFR-SHS de l'Université de Cocody et à l'UCAO-UUA.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire