INTRODUCTION
Le terme néo-thomisme est un terme composé du préfixe néo, qui sert à désigner une certaine école philosophique, pour la rattacher au thomisme, une école antérieure qu'elle continue à quelques égards. Par thomisme, nous entendons l' "ensemble des doctrines de St Thomas d'Aquin"(1) ou plus généralement, l'ensemble des doctrines qui s'inspirent de St Thomas d'Aquin, soit au moyen-âge, où le thomisme est opposé au scotisme ou à occamisme, soit à l'époque moderne, où un mouvement très actif de retour aux idées fondamentales de cette philosophie s'est manifesté sous l'influence de l'Encyclique Aetrni patris (1879), dans laquelle Léon XIII recommandait d'incorporer à la doctrine générale de St Thomas les résultats acquis des recherches scientifiques contemporaines. Ce mouvement est souvent désigné sous le nom de néo-thomisme.(2) Le néo-thomisme est un renouveau de la philosophie thomiste élaboré à la fin du XIXè siècle et au début du XXè siècle, à l'initiative du pape Léon XIII et de son encylique citée plus haut. A sa suite, Pie X voit dans le thomisme un seul rempart efficace contre le modernisme. L'approbation des 24 thèses thomistes en 1914 fait du thomisme la philosophie officielle de l'Eglise catholique. Cette philosophie est réaffirmée par Benoît XV dans son encylique Fausto appetente en 1921.
Les querelles furent vives, après cette encyclique de Léon XIII entre les thomistes et les néo-thomistes. Les thomistes étaient ceux qui, pour suivre les instructions de Léon XIII, revenaient aux doctrines de St Thomas. Les autres, les néo-thomistes, continuaient à admettre qu'il y eut au moyen-âge d'autres scolastiques que les thomistes. Nous retiendrons comme néothomistes, la liste que nous livre l'Encyclopédie Philosophique Universelle. Les Œuvres Philosophiques. Dictionnaire 2: Mercier Désiré-Joseph, Valensin Auguste, Lacroix Jean, Mascall Eric Lionelle. A cela nous pouvons citer bien d'autres comme Jacques Maritain, Etienne Gilson, Gabriel Marcel, Sertillanges...
1. MERCIER Désiré-Joseph
1. SA VIE
Selon le Dictionnaire des philosophes (3), Mercier Désiré-Joseph est un prélat belge, qui est né le 21 Novembre 1851 à Braine-l'Alleud près de Malines. Il entre en 1870 au séminaire archiépiscoapl de Malines, et est ordonné prêtre le 4 avril 1874. En 1882, il est nommé professeur de philosophie à l'université catholique de Louvain où il avait conquis ses grades. Il meurt mort à Bruxelles en 1926. Professeur de philosophie au séminaire de Malines, puis à l'Université de Louvain (1882), il faut directeur de la Revue néo-scolastique. Il fut nommé archevêque de Malines le 25 mars 1906, puis Cardinal en 1907. En 1879, le pape Léon XIII avec l'encyclique Aeterni Patris imposa l'enseignement de la philosophie dans les séminaires et dans les instituts universitaires catholiques. Lorsqu'une telle chaire fut créée à l'Université catholique de Louvain, pa rdésir express du pontife, elle fut confier au chanoine Mercier. Celui-ci se donna pour tâche de raviver la doctrine thomiste et d'élargir personnelement ses connaissances dans le champ des sciences physiques et naturelles, tenant compte du progrès irrésistible de celles-ci dans le cadre épistémologique leur incombant et en pleine mutation. En 1889, sa chaire fut transformée en institut et, dépassée la crise produite par l'hostilité d'un groupe de catholiques belges, l'Institut supérieur de Philosophie reçut en 1894 sa constitution définitive. De 1921 à 1925, Mercier dirigea, en qualité de représentant des catholiques, les conférences tenues avec des éléments de l'Eglise anglicane, coiffée par lord Halifax, pour la réunion des églises chrétiennes; mais sans résultat positif. L'enseignement de Mercier, ainsi que celui de quelques-uns de ses plus anciens élèves, devenus ses collaborateurs, se concrétisa par la formation à Louvain d'une école philosophique originale empreinte de tendances néo-scolastiques dont la revue néo-scolastique fut l'organe. D'autre part il exerça une vive influence auprès des hommes les plus en vue de la vie politique belge.
2. SES ŒUVRES
1. CRITERIOLOGIE GENERALE OU THEORIE GENERALE DE LA CERTITUDE 1899
Mercier manifeste son souci d'une reprise originale de la pensée de st Thomas, dans le contexte d'une époque où manquent la confiance en la raison et la soumission de l'intelligence à la réalité. Contre les vues réductrices du positivisme et du scienticisme, il s'agit d'établir les droits respectifs des sciences et de la métaphysique spéculatives. Sans tomber dans le dogmatisme exagéré de certains néothomistes, on établira le motif suprême de la certitude, à la fois contre l'extrinsécisme traditionaliste et contre le psychologisme kantien. Si Mercier refuse les simplifications qui ont cours dans les milieux catholiques, il n'en mène pas moins, avec Kant, une discussion serrée, sans cesse reprise au cours de l'ouvrage. Au "subjectivisme kantien", il oppose l'évidence objective qui motive nos jugements d'ordre idéal; à "l'idéalisme phénoméniste" de Kant, il oppose la réalité objective de nos concepts. Bien que cette critériologie générale n'ait pas été suivie, comme prévu, d'une critériologie spéciale, examinant la certitude de nos différents types de connaisances, elle a exercé une forte influence sur l'épistémologie néo-thomiste.(4)
2. LOGIQUE
3. METAPHYSIQUE GENERALE OU ONTOLOGIE
4. PSYCHOLOGIE
5. LES ORIGINES DE LA PSYCHOLOGIE CONTEMPORAINE
2. VALENSIN AUGUSTE 1879 - 1963
1. SA VIE
Philosophe français. Disciple de Maurice Blondel, ami de X. Léon rénovateur de l'étude de Fichte en France, Valensin est un représentant important du "néo-thomisme".
2. SES CITATIONS
«Ce n'est pas parce que je rêve de Dieu qu'il est, c'est parce qu'il est que je rêve de lui.»
«La science, comme la philosophie, ne peut suffire à contenter le coeur de l'homme.»
«Dieu a créé le temps pour nous, afin que nous ayons le moyen de nous reprendre au lieu d'avoir à jouer notre destinée d'un seul coup.»
3. SES ŒUVRES
1. A TRAVERS LA METAPHYSIQUE 1925
L'ouvrage rassemble divers essais philosophiques. Le principal concerne le panthéisme. Valensin expose ses formes spinozistes et fichtéenne avant d'en présenter une réfutation qui se fonde sur la position de la liberté humaine, et sur une théorie de l'analogie de l'être, développée dans un autre essai. La conjoncture de l'époque intervient. Disciple et ami de Maurice Blondel, Valensin était untervenu par son article de 1911 sur "La méthode d'immanence" dans la controverse suscitée par le renouvellement blondélien de l'apologétique. L'essai sur le panthéisme entend ruiner les bases du "modernisme immanentiste", condamné en 1907 par l'encyclique Pascendi.
Un autre ensemble concerne le criticisme kantien. Parce que la métaphysique morale laisse intact l'agnoticisme théorique, l'auteur conclut à l'incompatibilité du kantisme et de la vérité catholique. Les notes sur le thomisme montrent que celui-ci constitue un véritable système philosophique unifié par la théorie de l'acte et de la puissance. L'ouvrage contient aussi une étude sur "L'histoire de la philosophie d'après Hegel". (5)
2. BALTHASAR, deux dialogues philosophiques, suivis de commentaires sur Pascal, Paris Aubier, 1934
3. Regards sur Platon, Descartes, Pascal, Bergson, Blondel, Paris Aubier, 1955
4. Correspondance Maurice Blondel-Auguste Valensin, éd. H. de Lubac, Paris, Aubier, 3t. 1957-1965.
3. JEAN LACROIX 1900-1986
1. SA VIE
Professeur de philosophie, français, Jean Lacroix, né à Lyon, aura été un enseignant d'exception qui orienta de nombreux étudiants vers l'Ecole normale supérieure, un conférencier recherché (De Tunis à Varsovie), un directeur de collection ("l'initiation philosophique"), le co-fondateur de la revue Esprit avec Emmanuel Mounier(Octobre 1932); mas il est d'abord connu parce qu'il fut longtemps chargé d'offrir à la société française comme à la communauté philosophique le miroir de sa propre activité théorique, par ses chroniques régulières dans le journal Le Monde; les plus notables échelonnés sur une trentaine d'années, ont d'ailleurs été rassemblés dans Panorama de la philosophie française contemporaine et dans les sentiments et la vie morale. Ce n'est pas une tâche mineure que de réfléchir l'écriture philosophique en effervescence.
Mais les arbres ne doivent pas cacher la forêt. Jean Lacroix a ouvert plusieurs chemins, au moins trois, et, à ce titre, inscrit son nom dans le XXè siècle:
- Si l'on accepte de mettre de côté ses ouvrages didactiques et si suggestifs sur Spinoza et le problème du salut, Kant et le kantisme - Jean Lacroix aura été l'un des premiers penseurs à éveiller à la lecture des théoriciens modernes de la société et de la démocratie: les traditionalistes d'abord, comme de Maistre et de Bonald qu'il a, dès ses premiers ouvrages, introduits (Itinéraire spirituel), mais surtout les socialistes français - sans oublier Jean-Jacques Rousseau auquel il voue une sorte de culte - : Saint-Simon, Fourier et surtout Proudhon, non moins qu'Aguste Comte auquel il consacra un ouvrage stimulant, l'un des meilleurs sur ce philosophe.
- Jean Lacroix a surtout vivifié un courant de la philosophie occidentale, le personnalisme - et ses deux derniers ouvrages y reviennent, c'est une des raisons de cette passion. D'une part, il convient d'accorder le plus possible une démonstration à l'enracinement, à l'histoire, aux situations, au naturel, à la limite même au biologique mais sans y réduire le sujet. Incarnation et transcendance, le personnalisme a toujours réuini les deux pôles et les a mis en dialogue l'un avec l'autre, pour reprendre un terme que les écrits de Jean Lacroix ont aimanté et acclimaté. Et Jean Lacroix brillera à explorer ce qui les dialectise. Par exemple les institutions, la famille, le travail, l'Etat, le droit; tous semblent d'ailleurs aussi périlleux (ils risquent d'étouffer, d'absorber, d'aliéner) qu'indispensables. Ce sont des médiateurs. Lacroix lutte contre le pur surnaturalisme; il vise donc à "incarner" sans perdre; par là il rejoint l'un de ses maîtres, Maurice Blondel, auquel il actualise le rationalisme nouveau ou la philosophie de l'esprit qui désormais prend en compte, au lieu de les ignorer, et de se clore sur elle comme jadis, le "pré-réflexif" et "autrui". "C'est un philosophe réflexif, Jean Nabert, qui l'affirme catgoriquement, aucune conscience n'est capable d'un accroissement d'être qu'elle n'en soit redevable tout d'abord à un dialogue avec une autre conscience. On pourrait presque dire paradoxalement que c'est ce qu'il y a de commun à Boutroux, Bergson, Blondel, Brunschvicg, qui triomphe dansla philosophie moderne. Le rationalisme n'est pas mort, il s'assouplit" (Encyclopédie française, Philosophie-Religion, Introduction)
- A travers l'examen de désir, de la culpabilité, de l'incroyance, le personnalisme de Jean Lacroix, sans abandonner l'essntiel de ses propres convictions, a su les replacer dans le monde contemporain en crise, à l'écoute autant du marxisme que des philosophies de l'absurde ou du désespoir. Ainsi, on ne lira pas sans passion son texte sur Le sens de l'athéisme moderne si inhabituel. L'athéisme n ' y est pas refuté, bien au contraire, il est intériorisé et reconnu comme valeur fructueuse. " L'athéisme est ce qui joue le rôle du jugement négatif dans la connaissance de Dieu. Par là comprend-on qu'un philosophe comme Lagneau, qui suspendait toute l'analyse réflexive à Dieu, ait pu affirmer que "Dieu n'existe pas"(p.36). L'athéisme salutaire et garde-fou - cette philosophie généreuse sait partout absorber ce qui la conteste, sans sophistique, assouplir les notions séculaires comme les valeurs les plus anciennes - aussi est-elle toujours présente, jeune et tonique.
2. SES OEUVRES
1. PERSONNE ET AMOUR Lyon 1944
2. MARXISME, EXISTENTIALISME, PERSONNALISME, Paris, PUF 1950
3. LES SENTIMENTS ET LA VIE MORALE 1952
Pour P. Ranson(6), il s'agit d'un petit livre qui reprend quelques-unes des meilleurs chroniques de Jean Lacroix dans le Monde. Il est une démonstation de personalisme, appliqué à la vie affective. L'auteur y discute notamment du sentiment, du caractère, de la cumpabilité, du sens de l'amour, de la vertu, du respect, de la sincérité, du travail, du temps et de l'éternité. La personne vit de la tension de l'individu et de la communauté; or la notion de sentiment et bien à la fois individuelle et sociale: "Le sentiment n'a pas seulement une face subjective: il est aussi - et peut-être surtout - ce qui nous adapte à l'objet". Maine et Bonald avaient vu une double face du sentiment: "L'opinion est le fait de la raison(...) soit le sentiment d'une chose, c'est être lié à elle, ne pas pouvoir en douter, faire corps avec elle.(...l'opinion a toujours un caractère individuel et le sentiment un caractère social." Ce qui intéresse Lacroix, ici, c'est que le sentiment n'est pas de nature uniquement psychologique, il est le lieu de la rencontre de la sensibilité et de la raison "et comme l'effort suprême vers l'unité personnelle." L'exemple même de ce caractère d'affection/régulation du sentiment est évidemment l'amour qui permet "la concélébration de l'un et du multiple dans la vie de l'esprit."
4. LA SOCIOLOGIE D'AUGUSTE COMTE, PARIS 1954
5. KANT ET LE KANTISME, Paris Puf 1959
6. LA CRISE INDIVIDUELLE DU CATHOLICISME FRANCAIS PARIS, 1970
7. SPINOZA ET LE PROBLEME DU SALUT, PARIS 1970
8. LE PERSONNALISME COMME ANTI-IDEOLOGIE 1972
La notion de personne étant réduite dans le néo-thomisme à l'individualité humaine, "la substance individuelle de nature rationnelle", le personalisme a pris en charge de définir peertinnemment la personne. G. Mounier, J. Lacroix, tous deux fondateurs d'Esprit, ont eu un rôle décisif dans cette entreprise. Dans l'introduction de ce petir livre, l'auteur cherche les prédécesseurs ou les maîtres du personnalisme: Renouvier, Prat, Secrétan, Scheler, Royce, Laberthonnière...Ce qui est le caractère propre du personnalime d'Esprit, c'est qu'il ne sépare pas individu et communauté: "Individu et communauté sont les deux catégories fondamentales de la personne: elles maintiennent en elle une tension qui l'oblige à toujours se dépasser." Dans un premier chapitre, Lacroix étudie les rapports de l'idéologie - ce qui se construit pour exciter la haine contre tel ou tel peuple, et donc contre la personne dans son intégrité - au personnalisme. Ce dernier est le primet de la personne humaine et ainsi n'est à proprement parler ni un système, ni une idéologie, ni même une philosophie au sens classique du terme. Les chap. 2 et 3. Personnalisme et foi - Personnalisme et croyance montrent que ce primat est celui de l'amour et l'expérience de l'autre - de l'Autre absolu fondant toute relation à Autrui. Pour Lacroix, "la découverte essentielle de la foi en l'homme" est normative "parce qu'elle est "en deça de la distinction de la conscience psychologique et de la conscience morale."
9. LA PHILOSOPHIE DE LA CULPABILITE PARIS PUF 1977
________________________________________________________________________________
(1) André(LALANDE).- Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie (Paris, PUF 1996), p. 1132.
(2) Ibidem, p. 1132
(3). Denis (HUISMAN).- Dictionnaire des philosophes K-Z (Paris, PUF 1984), p. 1988
(4) J. COLIN.- Dictionnaire des Œuvres Philosophiques,II (Paris, PUF, 1992), p. 2676.
(5) J. COLIN.- Ibidem, p. 2901
(6) P. RANSON.- Dictionnaire des Oeuvres philosophiques, p. 3439
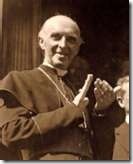
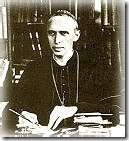


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire