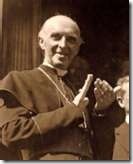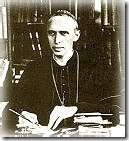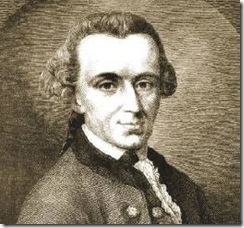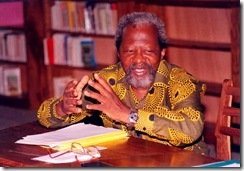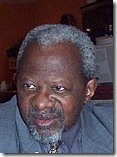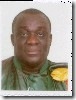INTRODUCTION
La question de l'environnement est un problème récent en philosophie. Pour Maurice KAMTO(1), l'environnement constitue un nouveau champ de recherche sans frontières, car il remet l'interdisciplinarité à l'honneur."Parce qu'il englobe tous les éléments de la nature reliés par des rapports d'interdépendance systématique, poursuit-il, l'environnement ignore les murs de souveraineté érigés par les Etats. Parce qu'il se conçoit à la fois comme connaissance du milieu naturel et protection dudit milieu, il transcende les frontières disciplinaires qui ceinturent les spécialistes et transforment le savoir scientifique en une tour de Babel." (2). Ainsi, définit-il l'environnement comme "l'ensemble de la nature et des ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et l'infrastructure humaine indispensable pour les activités socio-économiques"(3) ou pour être plus précis "on entend par environnement, le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie."(4). Cette définition, aux dires de notre auteur, prend en compte les composantes traditionnelles de l'environnement, à avoir la nature(constituée des espèces animales et végétales et des équilibres biologiques naturels) et les ressources naturelles (composée de l'eau, l'air, le sol, les mines), d'autre part, elle intègre des éléments nouveaux dégagés au cours du développement de la pensée environnementaliste (le patrimoine culturel" et "l'infrastructure humaine". En effet, pour Jean BAIRD CALLICOT(5), c'est seulement en 1960 que des indices ménaçant l'environnement commencèrent à se manifester: érosion des sols, pollution atmosphérique et aquatique, diminution du nombre des oiseaux, invations d'insectes nuisibles, plages souillées par des marées noirs. L'évolution régressive de la qualité de l'environnement en Afrique, est devenue, au fil du temps, une réalité inquiétante. Dans sa stratégie environnementale, Douzo KOUBO propose des mesures simples mais efficaces comme celle "visant à réduire les substances polluantes(le gaz carbonique) émises par le secteur des activités industrielles"(6), "la réglementation de l'activité de chasse"(7). Mais nous sommes d'accord avec lui que le véritable problème, c'est l'information. Il faut informer et former à l'environnement, car c'est cette action conjuguée qui permettra une lisibilité des politiques de nos gouvernants et l'acceptation des contraintes qui y sont liées. Ce sera l'objet de notre première partie. Puis, nous verrons comment la philosophie permet de mieux comprendre la question de l'environnement en revenant à la Phusis des Grecs.
1. UNE POLITIQUE D'INFORMATION ET DE FORMATION
A. BOURGOIN-BAREILLES dans son guide de l'environnement à l'usage des citoyens et des collectivités territoiriales nous fournit un outil indispensble pour mieux pratiquer lenvironnement. Il s'agit d'appprendre en tant que citoyen à "ne pas polluer, économiser les ressources naturelles, produire afin de respirer sans crainte, boire et consommer sans risque, habiter et vivre sans danger"(8). Pour cela, il faut connaître les règlements, les techniques, les aides, les assistances que constitue le référentiel de l'environnement(9). Il faut d'abord une bonne administration de l'environnement et des comptences communales.
1. ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET COMPETENCES COMMUNALES
A. BOURGOIN-BAREILLES trouve très important, le rôle que jouent les communes dans les politiques environementales. En effet, le maire doit veiller à l'ordre, la sécurité, la salubrité, la tranquillités publiques et les Services municipaux gèrent les questions d'eau, de déchets, d'énergie. De plus, les communes ont un rôle primordial dans la gestion du patrimoine foncier, urbain, rural, et des dispositifs règlementaires (schémas d'aménagement, paln d'occupations des sols...) structurent leurs actions auquelles peuvent s'ajouter des démarchent telles que les Chartes pour l'environnement. Tout ceci a un coût.(10) Si la répartition des compétences environnementales a une plus longue pratique dans la communauté européenne et dans l'Etat français(11), D.M. KABALA pense qu'il faut déclarer un état d'urgence en Afrique. Pour lui "l'état de l'environnement africain, qui a subi les effets de politiques inadéquates et d'une aide au développement dans l'ensemble inappropriée et mal utilisé, est l'objet de préoccupations grandissantes, notamment en ce qui concerne l'équilibre de ses différents écosystèmes et de ses ressources naturelles ainsi qu'en ce qui concerne ses possibilités d'évolution."(12) La Côte d'Ivoire, en ce cas précis, n'est pas une exception, au regard de la loi n°96-766 du 3 Octobre 1996, portant Code de l'Environnement. Ici, c'est" l'Etat qui s'engage à faire de l'environnement et de sa protection une politique globale et intégrée", à "prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations découlant des conventions et accords internationaux auxquels il est partie" à "interdire toute activité menée sosu son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible d'entraîner une dégradation de l'environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale", d' "oeuvrer en toute coopération avec les autres Etats pour prendre les mesures contre la pollution transfrontière"(13). Mais l'Etat n'est pas seul dans sa tâche. Il est aidé des collectivités locales qui "sont responsables de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets ménagers. Cette action peut être entreprise en laison avec les départements et les régions ou avec des groupes privés ou publics habilités à cet effet. Elles ont l'obligation d'élaborer des schémas de collecte et de traitement des déchets ménagers avec le concours des services techniques des structures compétentes. Elles assurent également l'élimination d'autres déchets qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, contrôler ou traiter."(14). Si nous connaissons ceux qui gèrent l'environnement à présent, il n'est pas sûr que nous sachions les nuisances dans leur particularité. Quedire par exemple du bruit?
2. LE BRUIT
L e bruit est placé, selon A. BOURGOIN-BAREILLES, au premier rang des nuisances de la vie quotidienne(15). Pour elle, les sources du bruit sont multiples et ses perceptions diffèrent selon les lieux et les personnes. Une musique peut être agréable pour certains et insupportable pour d'autres; en revanche le bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien est incommodant pour tous et va en s'accentuant. La nocivité est fonction de la durée, de l'intensité, de la répétition, de l'horaire d'émission. Pour le législateur ivoirien, la "nuisance est toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur fait ou non, par l'émission de bruits, de lumière, d'acteurs.."(16). Il faut donc un code qui "améliore les conditions de vie des différents types de population dans le respect de l'équilibre du milieu ambiant."(17). Comme nous le constatons cette législation fait une différence entre bruit et nuisance. Le Régime de l'interdiction s'applique à la fois aux bruits excessifs et aux bruits nuisibles pour la santé.
Un bruit correspond, pour J.-F. BEAUX(18) à un ensemble de sons perçus par l'organisme comme une sensation désagréable et gênante. Un son est une vibration de l'air, se déplaçant à la vitesse de 343 mètres par seconde, et dont on peut définir la fréquence et l'intensité. La fréquence, mesurée en herz(Hz) mesure la hauteur du son et est d'autant plus élevée que celui-ci est aigu. La nuisance sonore est estimée en décibels(dB), la valeur 0 correspond à la limite de perception de l'oreille. Il faut surtout se souvenir que, dans cette échelle, toute augmentation de 3dB traduit un doublement du niveau sonore. Par ailleurs, la perception de celui-ci apparaît accrue pour les fréquences les plus basses et les plus hautes. La nuisance d'une source de bruit diminue avec la distance, un doublement de celle-ci s'accompagnant d'une réduction de 5 à 6 dB environ.
La nocivité d'un son, poursuit J.-F. BEAUX(19), dépend d'abord de son intensité, qui devient dangereuse à partir de 85 à 90 dB, valeurs pour lesquelles se développent les premiers dommages auditifs. Elle dépend également de la fréquence et du rythme d'application (répétition obsédante ou survenue inopinée de certains bruits). Les deux conséquences majeures d'une exposition prolongée au bruit sont, d'une part, lle développement d'une surdité et, d'autre part, l'apparition de différents troubles nerveux.
Les surdités causées par le bruit, affirme-t-il(20), s'observent dans certains environnements industriels dont le niveau sonore provoque des dommages, voire une destruction des cellules auditives de l'oreille interne. Ces surdités, dont certaines sont reconnues comme maladies professionnelles, s'installent de manière lente, irréversible et peuvent continuer de s'aggraver même après suppression des causes. Leur prévention nécessite un suivi régulier des personnes exposées et l'arrêt de l'exposition aux nuisances dès les premiers troubles. Ceux-ci peuvent correspondre à l'apparition d'un atrou auditif vers la fréquence de 4 000 Hz, où les sons ne sont plus entendus qu'au-delà d'une intensité anormalement forte. Ces troubles peuvent disparaître avec l'arrêt des nuisances sonores. Dans le cas contraire, la surdité s'accroît, notamment dans l'intervalle de fréquences correspondant à la parole (1000-2000Hz).
Finalement, conclut notre auteur(21), le bruit est également susceptible d'amoindrir les capacités de concentration et de réflexion. Il perturbe le sommeil, même si l'accoutumance permet finalement celui-ci dans un environnement bruyant, et aggrave les états irritables ou dépressifs. La lutte contre le bruit fait l'objet de réglementations rigoureuses. Les progrès techniques ont permis de réduire les nuisances industrielles et d'améliorer l'isolation phonique des habitations. Divers aménagements (murs antibruit, couverture des voies...) visent à atténuer les troubles liés aux transports. Après le bruit, les déchets constituent un élément important qui déstabilise notre environnement.
3. LES DECHETS
La modernisation de la gestion des déchets, aux dires de A. BOURGOIN-BAREILLES(22) répond à une demande écologique et sociale: celle de voir cesser les pollutions du sol, de l'air, de l'eau, et des paysages, dues aux décharges traditionnelles. Les déchets constituent un sujet qui devient chaque jour de plus en plus d'actualité : les citoyens se voient proposer des conteneurs pour la collecte sélective des papiers, du verre, des plastiques...les entreprises ont légalement la responsabilité de leurs déchets, les collectivités se mettent aux normes des plans départementaux d'élimination des déchets...sans oublier les coûts imputables aux uns et aux autres que génèrent les déchets, coûts en constante augmentation. Mais à ce stade, savons-nous réellement ce qu'est un déchet?
Il y a, pour J.-F. BEAUX(23), différents types de déchets. Les déchets produits par les activités humaines peuvent être d'origines ménagère, industrielle ou agricole (agriculture et industries agro-alimentaires). En Côte d'Ivoire, la loi N° 96-766 du 3 octobre 1996, portant code de l'environnement, définit les déchets comme " des produits solides, liquides ou gazeux, résultant des activités des ménages, d'un processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonné ou qui menace ruine. les déchets dangereux sont des produits solide liquides ou gazeux, qui présentent une menace sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, la sécurité des êtres vivants et la qualité de l'environnement.(24). Le Code poursuit plus loin en disant que "tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et dangereux, doivent être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou réduire les effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, sur la faune et la flore et sur la qualité de l'Environnement." (25) Quant à la l'enfouissement dans le sol et le sous-sol de déchets non toxiques, il ne peut être opéré "qu'après autorisation et sous réserve du respect des prescriptions techniques et règles particulières définies par décret"(26). L'élimination des déchets, néanmoins pose un problème. Elle doit respecter les normes en vigueur et être conçue de manière à faciliter leur valorisation. A cette fin la loi fait obligation aux structures concernées de: "développer et divulguer la connaissance des techniques appropriées; conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets; réglementer les modes de fabrication"(27) Par conséquent, des dispositions préventives et des dispositions pénales sont prises comme l'interdiction de "rejeter dans les eaux maritimes et lagunaires des eaux usées, à moins de les avoir préalablement traitées conforméméent aux normes en vigueur; des déchets de toutes sortes non préalablement traités et nuisibles." mais aussi de "de détenir ou d'abandonner des déchets susceptibles de favoriser le développement d'animaux vecteurs de maladies, de provoquer des dommages aux personnes et aux biens". (28) Nous comprenons la réaction mésurée du Prof. DIBI à propos de l'épisode des déchets toxiques dans notre pays. L'excellent philosophe écrit: "Il est une évidence : le temps de notre pays, comme il va, est, depuis quelques années, rythmé d’événements qui se déroulent à une vitesse tout à fait inhabituelle. A la crise ayant conduit à un conflit armé dont nous ne cessons de vivre les conséquences, fait suite une situation révélant symboliquement ceci : à chaque fois, vient nous offrir ses fruits, à l’extérieur et maintenant, sous une forme de déchets toxiques, ce que nous avons nourri à l’extérieur de nous-mêmes.
Quelque chose dans notre pays ne e trouve-t-il pas cassé, comme on le dit d’une montre dont le ressort ne fonctionne plus pour marquer l’heure ? Les figures de cette cassure se peuvent lire sous les traits de la suspicion, de la méfiance à l’égard du prochain le plus immédiat, de l’exil de l’autre dans l’indifférence et du regard obscur porté sur la personne venue d’ailleurs. Elles voient leur accomplissement ultime dans l’irruption d’un patriotisme instinctif, non éclairé, fait de la bouillie du cœur, oubliant que la république, en son concept, est la médiation conduisant l’individu à se tenir dans l’ouvert, en apprenant simplement à devenir AMI DE L’HOMME, quel qu’il soit. En réalité, la manière de regarder l’autre que nous considérons comme bouchant notre horizon n’est-elle pas liée à la manière dont nous nous regardons nous-mêmes ? Ne procède-t-elle pas d’une perversion intérieure, consistant à vouloir occuper seuls l’horizon, à tout ramasser pour ramener fiévreusement à nous uniquement toute la sphère de l’étant ? Une parole juive dit : « quand notre amour était fort, nous pourrions dormir sur le tranchant de l’épée. Aujourd’hui qu’il ne l’est plus, même un lit de soixante aunes ne nous suffit plus. » Quand ne nous suffit plus même un lit de soixante aunes, c’est le signe que désormais, en notre cœur, n’existe plus de place pour accueillir l’autre, pour recevoir l’homme en général, en un mot, pour tendre la main à l’humain.
N’est-ce pas parce que nous avons résolument tourné le regard vers l’univers de l’avoir et que désormais bouillonne en nous la voix des désirs érigée en absolu ? ... Lorsqu’une communauté se soucie uniquement de conjuguer le verbe « AVOIR », sans, une seule seconde, diriger son regard vers le verbe « ETRE », ne fait-elle pas choix d’une culture quantifiante, ne proposant à l’homme que la consommation, c’est-à-dire, élevant à l’absolu sa dimension animale ? Faire de l’avoir le but ultime de la vie, c’est, au fond, indéfiniment avoir des dettes, car abandonnés aux mirages du désir, créant toujours un vide à combler, nous avons en n’ayant pas…n’étant pas de soi-même normatif et ne pouvant nous offrir ni équerre ni compas pour cette raison, le quantitatif nous rend lourds, et nous tournons en rond ! Tel est le destin de ce qui a pour seule consistance l’inconsistant, la poussière des phénomènes !
En acceptant que soient déversés sur notre sol des déchets toxiques, ne manifestons-nous pas à quel point l’odeur de l’argent et la fièvre de l’enrichissement facile nous ont rendus insensibles au cri et à la splendeur de l’humain ? Le sage dit : « ce que tu fais, te fait ; ce que tu nourris, te nourrit ». C’est la rouille de notre or et de notre argent qui vient nous condamner. Comment, en ce geste d’accepter des déchets toxiques, ne pas voir nos impuretés intérieures, entretenues au fond de notre être, venues tapageusement et tragiquement se manifester à la surface ? Il vient d’être, révélé qu’une citerne de ces déchets semant la mort a été même enterrée dans une boulangerie ! la boulangerie est Un lieu ordonné au service de la vie, et cette circonstance signifie que c’est jusqu’au levain de la pâte de la vie qu’il est porté atteinte…Que l’odeur nauséabonde des déchets ait attiré l’obtention des populations pour révéler les choses à la lumière du jour, relève de la main bienveillante du destin voulant nous montrer la statue que nous avons sculptée de nous-mêmes, les traits hideux du veau d’or que nous ne cessons d’adorer et qui risque de nous transformer en des passagers obscurs, au regard sépulcral, sur une terre où pourtant doivent fleurir le beau, le vrai et le bien.
Chacun le sait : dans cette affaire, les responsables ne sont pas des personnes ordinaires, priant quotidiennement pour que leur soient assurées simplement nourriture, santé et paix. Les responsables sont en haut et ce point ne peut que sérieusement nous inquiéter ! Dans la constitution de l’être humain, ce n’est pas un hasard si la tête se trouve en haut, et non en bas. Les pieds ne peuvent aller que là où la tête a quelque projet. Les premières paroles de l’aveugle de Bethsaïda guéri par le Christ furent : « Je vois des hommes, et je vois comme des arbres qui marchent ». Par sa stature droite, l’arbre nous fait sentir intuitivement ce qui est juste. N’appartient-il pas à l’homme d’accomplir ce qui est pressenti, en marchant de manière droite, c’est-à-dire au fond, en volant de l’arbre vers le ciel, comme l’oiseau ? Lorsque la tête n’est plus tête que de nom, parce qu’elle est devenue un nid désordonné d’obscurs instincts, lorsqu’elle cherche à tâtons la porte de sa propre maison, comment peut-elle conduire d’autres personnes à bon port ?
C’est pourquoi s’impose, irréductible, indépassable et incontournable l’éthique du juste, assurant la sauvegarde des valeurs essentielles, en se tenant debout sur les tours de la conscience humaine, sur les promontoires du monde, afin de ralentir la dégradation du milieu humain. Sans doute, dans une société où se font de plus en plus envahissantes les passions les plus basses, l’on est prêt à dénigrer toute idée de mérite, d’excellence, et le juste a même honte de sa pureté…Mais le nivellement par le bas n’est pas une mesure, et « foule des sots ne peut égaler un sage », pour parler comme Giordano BRUNO ! Sans l’exigence de droiture, l’homme ne serait qu’un point d’interrogation dans le monde, car personne ne pourrait dire pourquoi il existe, et mieux vaudrait pour lui chercher, au plus tôt, à disparaître s’il lui fallait vivre n’importe comment, se développer en tous sens, au hasard !
Qui fait attention à la vie sait que « le désordre ne sort pas de la terre, le malheur non plus ne germe pas du sol». Ils trouvent leurs racines en nous-mêmes, mais nos bassesses meurent de leur propre poison. L’événement des déchets toxiques ne traduit-il pas l’enflure de nos impuretés désormais venues elles-mêmes se présenter à la surface, afin d’être chassées par la pureté et nous aider, à préparer, par une action incessante et féconde, l’avènement d’une société meilleure et plus éclairée ?"(29)
4. L'AIR
Les problèmes de pollution de l'air dans les grands centres urbains font de plus en plus souvent l'actualité des médias. les médecins constatent l'accroissement des crises d'asthme depuis quelques années dont les polluants de l'air sont largement suspectés d'être la cause aggravante si ce n'est déclenchante. Les "pluies acides" passent au-dessus des frontières. La raréfaction de la couche d'ozone ("naturel", stratosphérique, dans les hautes couches de l'atmosphère) et le rechauffement de l'atmosphère) traduisent l'aspect planétaire de la problématique de l'air.(30) Les symptômes les plus fréquents, pour J.-F. Beaux(31) correspondent à des inflammations des muqueuses et à des troubles respiratoires. Des substances telles que certains hydrocarbures ou des particules ont vraisemblablement des effets canncérigènes. L'étendue des nuisances que la pollution peut faire subir à l'organisme est difficile à établir avec précision. Il est en particulier difficile d'analyser séparément l'impact des diffents constituants inhalés sous forme de mélange. En outre, les concentrations ne suffisent pas pour définir les dangers potentiels: il peut exister des effets à long terme, aux conséquences pathologiques différées; ainsi, l'exposition à des fibres d'amiante, utilisées dans la construction jusque dans les années 60 et 70, commence aujourd'hui seulement à révéler ses dangers. Enfin, les effets de plusieurs substances peuvent s'ajouter. La pollution peut ainsi agir comme facteur aggravant du tabagisme. Les études actuellement menées font apparaître des corrélations nettes entre pics de pollution et affections, notamment chez les jeunes enfants et les personnes souffrant déjà de problèmes respiratoires.
Une des causes de décès fréquents dans le monde est l'inhalation domestique accidentelle au monoxyde de carbone. Cette intoxication est la première cause de mortalité accidentelle par toxiques, provoquant chaque année plusieurs cas d'hospitalisations. Le monoxyde de carbone résulte d'un mauvais fonctionnement d'appareils de chauffage ou de chauffe-eau à gaz qui peut se concentrer sans être détecté et entraîne rapidement la mort. L'intoxication est aisée car l'hémoglobine (protéine du sang qui assure normalement le transport de l'oxygène des poumons aux cellules) possède une affinité beaucoup plus grande pour le monoxyde de carbone: il suffit que, dans une pièce la concentration de celui-ci atteingne 1/200è de la concentration de l'oxygène (soit environ un litre de CO pour 1000 litres d'air contenant 21% d'oxygène) pour qu'il soit préférentiellement fixé sur l'hémoglobine. Il y a alors blocage du transport de l'oxygène. Ce blocage provoque une baisse importante de l'alimentation en oxygène (ou anoxie), particulièrement grave pour certains organes comme le cerveau et le coeur. Des intoxications très brutales peuvent entraîner une mort quasi instantanée. D'autres, plus lentes, débutent par des maux de tête et une sensation de malaise qui se poursuivent rapidement par une entrée dans le coma. Pour lutter contre l'empoisonnement, on fournit au malade de l'oxygène à haute pression pour remplacer le monoxyde de carbone par l'oxygène dans l'association avec l'hémoglobine.
5. L'EAU
Elément essentiel de la biosphère, l'eau suit un cycle gouverné par le soleil et la gravité dont les influences se manifestent par les précipitations, le ruissement, l'évaporation, ainsi que par l'activité des êtres vivants dans la photosynthèse. La belle image de notre planète bleue, montre, selon A. BOURGOIN-BAREILLES(32), la prééminence de l'eau qui recouvre à 72% sa surface (97% d'eau salée, 2% d'eau douce gelée aux pôles, et moins de 0,5% d'eaux souterraines et cours d'eau). Pourtant une grave crise de l'eau se profile d'ici 2050, c'est ce qui ressort du 1er Forum mondial de l'eau (Marrakech-mars 1997). Les hauts responsables présents ont attiré l'attention sur l'amenuisement de cette ressource vitale du fait de l'explosion démographique, de l'industrialisation, des cultures intensives, d'une mauvaise gestion (gaspillage et pollution). Les 20% les plus riches de la population mondiale consomment 80% des ressorces, et plus d'un millard d'êtres humains n'ont pas accès à une eau saine. Actuellement 7 300 m³ d'eau sont disponibles annuellement par habitant; cette moyenne théorique devrait baisser à 4 800 m³ en 2025. Des conflits mondiaux pour l'eau sont sous-jacents en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Citons heureusemet la création d'institutions qui travaillent à résoudre des litiges sur l'eau: la Commission sur le delta du Mékong, la Commission du Rhin, la Coopération des Républiques riveraines de la mer d'Aral. Mais les institutions de l'ONU sont encore mal équipées pour faire face aux questions de scurité écologique. Il est urgent d'apprendre à gérer ce bien précieux qu'est l'eau. Le PNUD et la Banque mondiale en sont conscients, dont les investissements ont été multipliés par deux ces vingt dernières années.
En Côte d'Ivoire, "les points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d'un périmètre de protection en vue de la conservation ou de la restauration des écosystèmes, forêts, boisements, espèces et espaces protégés, monuments, sites et paysages, systèmes hydrauliques et de la qualité des eaux"(33). Toute activité qui veut nuire à la quaité des eaux est interdite ou peut être réglementée à l'intérieur des périmètres de protection. Le code ajoute également que "les cours d'eau, les lagumes, les lacs naturels, les nappes phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes sont du domaine public."(34) Ainsi donc, en Côte d'Ivoire, leau synonyme de pureté inépuisable n'est pas épargnée. Les eaux côtières subissent les rejets d'eaux usées. Les plans d'eau et rivières souffrent d'eutrophisation (phosphate dissous) ou d'anoxie (déficit en oxygène), d'où la proliféraion de matières nauséabondes à la surface de l'eau, voire de poissons morts, que déplorent riverains, promeneurs, pêcheurs. Les euax pluviales en ruisselant recueillent la pollution déposée sur les toits, les caniveaux, les routes, et entraînent cette pollution urbaine dans les cours d'eau et nappes phréatiques. Les eaux potables elles-mêmes deviennent non coformes au plan bactériologique notamment du fait des nitrates provenant de l'agriculture. (35)
_______________________________________________________________________________________
(1) Maurice KAMTO.- Droit de l'environnement en Afrique (Paris, Edicef 1996), p. 20
(2) Maurice KAMTO.- O.c., p. 20
(3) Ibidem, p.16
(4) Ibidem, p. 16
(5) Jean BAIRD CALLICOT.- "environnement" dans Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale (Paris, PUF 1996), p. 498
(6) Douzo KOUBO.- Lastratégie environnementale en question (Côte d'Ivoire) (Paris, l'Harmattan 2003) , p.16
(7) Ibidem, p. 17
(8) Préface de Michel JORAS dans A. BOURGOIN-BAREILLES.- Guide de l'environnement à l'usage des citoyens et des collectivités terrotoriales (Paris, Frison-Roche 2000)
(9)Ibidem.
(10) A. BOURGOIN-BAREILLES.- O.c., p.5
(11) O.c., p. 6 et ss
(12)D.M. KABALA.- Protection des écosystèmes et développement des sociétés. Etat d'urgence en Afrique (Paris, L'Harmattan 1994), p.36
(13) Article 55
(14) Article 66
(15) A. BOURGOIN-BAREILLES.- O.c., p. 41
(16) Article 1
(17) Article 2
(18) J.-F. BEAUX.- L'Environnement (France, Nathan/Vuef 2002), p.110
(19), Ibidem, p. 110.
(20 Ibidem, p.110.
(21) Ibidem, p. 110
(22) A. BOURGOIN-BAREILLES.- O.c., p. 57
(23)J.-F. BEAUX, O.c., p. 124
(24) Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 Code de l'environnement, article 1.
(25) Article 26
(26) Article 27
(27) Article 28
(28) Articles 77,78
(29) Prof. A. DIBI KOUADIO Article inédit.
(30) A. BOURGOIN-BAREILLES.- O.c, p. 95
(31) J.-F. BEAUX.- O.c., p. 42.
(32) A. BOURGOIN-BAREILLES.- O.c., p. 137
(33) Code articles 13 et 51
(34) Article 37
(35) A. BOURGOIN-BAREILLES.- O.c., p. 138.